Qu'est-ce qu'une variété ?
Une variété c'est...
Au niveau du classement du monde végétal, l’espèce est le rang auquel les plantes sont, le plus souvent, connues. Ce rang est important car il caractérise un groupe de plantes qui ne peuvent se reproduire qu’entre elles. La variété est un rang taxonomique inférieur à l’espèce.
En agriculture, la variété correspond à une population de plantes d’une espèce données qui a été sélectionnée et cultivée souvent depuis des millénaires pour des caractères répondant aux besoins des hommes.
Au cours du 20° siècle, l’homogénéité et la stabilité des variétés ont été privilégiées, pour garantir aux utilisateurs l’identité de la variété, pour homogénéiser les cultures et pour faciliter le travail des utilisateurs et des transformateurs avec des productions de qualité régulière.
| Liste | Définitions | Nb de variétés au 30/06/2017 |
| A | Variétés dont les semences peuvent être multipliées et commercialisées en France et par extension en UE
| 2935 soit 80% |
| B | Variétés dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation hors de l’UE
| 681 soit 19% |
| C | Variétés de conservation cultivées traditionnellement dans des régions spécifiques et menacées d’érosion génétique (DHS allégée).
| 11 dont 10 variétés de pomme de terre et 1 mais (population Lacaune) |
| P | Parents d’hybride pour les céréales à paille | 7 |
| V | Associations variétales dont les semences peuvent être multipliées et commercialisées en France, et par extension en UE
| 2 variétés de colza |
Pour répondre aux besoins de certains utilisateurs, il existe en plus du catalogue officiel, la liste des Variétés à Usage Industriels Réservés :
| Liste | Définitions | |
| I | Liste I ou liste VUIR, Variétés à Usages Industriels Réservés (arrêté du 30 août 1994)
|
| Liste | Définitions | Nb de variétés au 30/06/2017 |
| A | Variétés dont les semences peuvent être multipliées et commercialisées en France et par extension en UE
| 2935 soit 80% |
| B | Variétés dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation hors de l’UE
| 681 soit 19% |
| C | Variétés de conservation cultivées traditionnellement dans des régions spécifiques et menacées d’érosion génétique (DHS allégée).
| 11 dont 10 variétés de pomme de terre et 1 mais (population Lacaune) |
| P | Parents d’hybride pour les céréales à paille | 7 |
| V | Associations variétales dont les semences peuvent être multipliées et commercialisées en France, et par extension en UE
| 2 variétés de colza |
Pour répondre aux besoins de certains utilisateurs, il existe en plus du catalogue officiel, la liste des Variétés à Usage Industriels Réservés :
| Liste | Définitions | |
| I | Liste I ou liste VUIR, Variétés à Usages Industriels Réservés (arrêté du 30 août 1994)
|

La Convention de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) définit la variété comme :
« un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être :
- défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,
- distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et
- considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »
Cette définition précise qu’une variété doit être reconnaissable à ses caractères, différer notablement de toute autre variété et demeurer inchangée au cours du processus de reproduction ou de multiplication.
Les variétés ont des structures génétiques différentes, plus ou moins homogènes, selon le mode de reproduction de l’espèce (autogame, allogame, multiplication végétative), la méthode de sélection et de l’effet de l’hétérosis (si cet effet est élevé, les hybrides ou plantes synthétiques seront privilégiés).
Ces structures ont également évolué ces 100 dernières années, avec en particulier le développement des hybrides.
La variété population est le résultat des premiers et longs processus de sélection opérés par l’Homme en cultivant des populations de plantes, en les domestiquant. Par la domestication, l’Homme transforme un ensemble de plantes sauvages en une population de plantes cultivées, encore assez variable, s’auto reproduisant entre elles. Progressivement, en l’adaptant à son environnement agro climatique et ses besoins, la population de plantes devient moins variable, car l’Homme supprime les plantes qui ne lui conviennent pas, consciemment ou pas. Cet ensemble de plantes devient une variété population cultivée, adaptée à ces conditions. Dans nos agricultures, les agriculteurs semenciers ont utilisé ce type de variétés du XVIII au début du XXème siècle.
De nos jours, il existe également en France de nombreuses variétés populations pour les espèces fourragères, forestières, ornementales, médicinales, aromatiques. Les matériels forestiers de reproductions, mis à part les clones, sont des populations. Les variétés populations n’ont pas disparu pour les autres espèces. Les établissements semenciers et les agriculteurs maintiennent et cultivent encore une centaine de variétés populations d’espèces allogames maraîchères : betterave d’Egypte, cardon Plein inerme, carotte de Colmar à cœur rouge 2, céleri Plein blanc, chicorée Grosse pommant seule, navet Rave du Limousin, poireau Jaune gros du Poitou…qui donnent satisfaction. Elles sont également conservées en tant que ressources génétiques.
Les variétés populations ont une base génétique large car composées de plantes apparentées mais suffisamment différentes. Les plantes qui la composent sont différentes et leur descendance hétérogène. [Ces plantes sont non fixées, hétérozygotes, leurs descendances non fixées].
Elles s’auto reproduisent suffisamment identiques à elle-même si elles sont suffisamment isolées et multipliées avec un nombre de plantes suffisamment importants. Plusieurs centaines de plantes, selon les espèces, sont nécessaires pour maintenir la conformité, une variabilité suffisante et éviter la consanguinité et donc la perte de vigueur. Si ces conditions ne sont pas réunies, elles peuvent « dériver » facilement (dérive génétique) et ne plus être conformes à leur définition d’origine. Leur multiplication nécessite donc une attention particulière : c’est le travail de la personne en charge de la sélection conservatrice.
Actuellement, les variétés populations connaissent un regain d’intérêt. En effet, pour certains, leur hétérogénéité génétique pourrait être un élément favorable pour la souplesse d’adaptation de la variété aux différents conditions climatiques et culturales.
Variétés fixées et lignées pures
Pour les espèces très autogames (blé, haricot, laitue, orge, pois….), celles ayant un taux d’allogamie faible (chicorée, mâche…) ou celles allogames supportant l’autogamie (colza, les cucurbitacées….), l’agriculteur a rapidement sélectionné des variétés plus homogènes :
variétés fixées (dont la plupart des caractères sont « fixés », acquis, d’une génération à une autre) : variétés fixées de chicorée, concombre, fève et féverole, mâche, melon, vesce…
et variétés lignées pures, très homogènes (issues de la multiplication d’une seule plante suffisamment « fixée » pour de très nombreux caractères): lignées pures de blé, haricot, laitue, orge, pois, seigle, soja…
Pour ces espèces, depuis la fin du 19ème siècle, les sélectionneurs créent , après hybridation, des variétés fixées lignées pures nouvelles (blé, haricot, laitue, orge, soja, tomate d’industrie) ou des variétés fixées (concombre, courgette, piment…). Ce sont des espèces où la production de variétés hybrides n’est pas réalisable car elles sont autogames ou pas nécessaire (cas où les variétés non hybrides conviennent : variétés lignées pures de tomate d’industrie, variétés fixées de chou-fleur, …).
La variété fixée et la variété lignée pure ont une base génétique étroite car composées de plantes apparentées identiques. Les plantes de ces variétés ont des descendances homogènes et identiques. [Ces plantes sont « fixées », homozygotes, leurs descendances sont « fixées »].
Les lignées pures s’auto reproduisent facilement et peuvent être maintenues conformes à partir d’un faible effectif de plantes
Les variétés fixées d’espèces allogames , créées en régime d’autogamie, sont des variétés d’un degré d’homogénéité moins important. Elles sont issues de variétés populations soumises à une forte pression de sélection pour un caractère particulier. C’est le cas des variétés fixées de carotte Touchon, Nantaise TipTop, chou fleur, chou, fenouil, oignon,…Pour leur multiplication, elles nécessitent les mêmes précautions d’isolement et d’effectif que les variétés populations.
Variétés hybrides
Depuis 1930, les sélectionneurs ont remarqué que des populations de plantes hybridées pouvaient présentées une vigueur, liée à leur génome hybride (vigueur hybride liée à l’hétérosis). Ils ont donc proposé des variétés hybrides résultant du croisement de plusieurs constituants parentaux. Cette vigueur est d’autant plus forte que les plantes hybridées, les constituants parentaux, sont éloignés génétiquement et suffisamment fixées : c’est la valeur des constituants parentaux en croisement. Elle s’exprime significativement chez les espèces allogames, moins en général chez les espèces autogames. Cette vigueur procure des qualités agronomiques pour l’installation du semis, la croissance, la nouaison, la productivité…
L’exploitation de la vigueur hybride a été maximalisée par des programmes de sélection basés sur la valeur de lignées pures en croisement hybride. La valeur des lignées pures est exploitée pour leur valeur en tant que parents d’hybrides performants. C’est l’hybride simple, F1, résultant du croisement de deux lignées pures, qui optimise le plus cette stratégie génétique. Cette stratégie est utilisée avec succès pour des espèces allogames comme le maïs, le tournesol, le sorgho, la carotte, des espèces de Brassica…Un progrès génétique significatif a été observé depuis plusieurs dizaines d’années.
Pour d’autres espèces, dont la biologie est différente, la stratégie optimale a été de sélectionner d’autres constituants parentaux : i) des familles de plantes (et non des lignées, comme chez la Betterave), ou ii) un ou deux hybrides F1 comme constituant parentaux (hybride trois ou quatre voies ou double chez le maïs, le tournesol, l’oignon, la carotte, le radis…) ou iii) un ou des clones comme constituants parentaux (hybrides de clones d’asperge, poireau, chou-fleur
La formule hybride permet aussi d’introduire plus facilement et rapidement des caractères recherchés par rapport à leur introduction dans une variété population. C’est le cas des hybrides F1 de concombre, courgette, melon, piment, tomate pour les caractères de résistances aux maladies et insectes (caractères mono géniques dominants). Le choix des constituants parentaux est un volet important du métier de sélectionneur de plantes hybrides.
Les variétés hybrides ont une base génétique qui dépend de l’éloignement de leurs constituants parentaux. Les plantes d’une variété hybride sont soit identiques (hybrides F1), soit variables (autres hybrides). Les variétés hybrides ne s’auto reproduisent pas : à chaque génération il est nécessaire de recommencer le croisement hybride. Il faut contrôler à grande échelle l’hybridation (suppression du pollen chez le parent femelle par castration, stérilité male d’origine génétique…). Avec en plus le maintien des constituants parentaux, cela constitue un coût de production de sélection et de semences commerciales important, mais permet à l’obtenteur de vendre les semences chaque année.
– Variétés synthétiques
Pour les espèces allogames où la sélection de variétés hybrides est trop complexe ou économiquement non appropriée, le sélectionneur a entrepris une stratégie de composition d’une population résultant du croisement de constituants parentaux, de manière libre, moins contrôlée et pendant une (poireau) ou plusieurs générations (graminées et légumineuses fourragères). Les constituants peuvent être des populations homogénéisées, des familles, des clones. C’est la dernière génération qui est mise en marché comme semences commerciales.
Par rapport à une population, elles présentent une meilleure stabilité (car les constituants sont identifiés et maintenus), une homogénéité supérieure selon le choix des constituants parentaux et une utilisation relative de la vigueur hybride.
Les variétés synthétiques ont une base génétique qui dépend étroitement de l’éloignement de leurs constituants parentaux. Les plantes d’une variété synthétique sont variables.
Les variétés synthétiques ne s’auto reproduisent pas en tant que telles : il est nécessaire de recommencer le croisement hybride à intervalles réguliers selon le nombre de générations estimé par le sélectionneur. Le contrôle de l’hybridation des constituants est moins précis que pour les hybrides. Le maintien des constituants parentaux, constitue un coût de production de sélection et de semences commerciales non négligeable par rapport à une variété population. Les variétés synthétiques peuvent donc s’auto reproduire avec des risques d’évolution non négligeables.
C’est une stratégie qui a été un succès important en France depuis 1945 pour les graminées et légumineuses fourragères.
– Variétés clones
Les variétés clones sont multipliées végétativement par la reproduction à l’identique d’un seul individu (clonage). Elles sont homogènes et stables, sauf mutation affectant l’un des individus. L’Homme a utilisé cette méthode de multiplication végétative depuis des temps ancestraux pour les espèces qui ont une capacité à bouturer, marcotter, faire des « éclats », des bulbes, bulbilles, caïeux, se greffer (arbres fruitiers, rosier, espèces de pépinières) … C’est ainsi que les anciennes variétés d’espèces fruitières, de vigne, de pomme de terre, de fraiser, d’ail, d’artichaut, d’espèces aromatiques et médicinales…se sont propagées d’une ferme à l’autre. Compte tenu des mutations intervenues sur un très grand nombre de générations et d’individus, ces anciennes variétés sont parfois des mélanges de clones (arbres fruitiers, ail, artichaut…).
A la suite de travaux conduits dans les années 1950, des techniques de cultures de tissus, in vitro, permettent de multiplier des variétés clones, indemnes de virus et phytoplasmes, chez les arbres fruitiers (porte greffe), la pomme de terre, le fraisier, des espèces ornementales, le palmier, des espèces forestières, de nombreuses espèces ornementales (orchidées, rosier potée fleurie, patate douce…).
Une variété clone a une base génétique très étroite puisqu’il s’agit d’une même plante, un seul génotype, un même phénotype multiplié à l’infini. Les plantes qui composent une variété clone sont identiques. Cette forte identité des plantes est un inconvénient si une maladie se développe favorablement sur cette variété clone : toutes les plantes sont sensibles ou contaminées. C’est une des raisons pour lesquelles les forestiers utilisent des peuplements hétérogènes pour exploiter la Forêt naturelle et non des variétés plus homogènes, à l’exception de variétés clones utilisées dans des productions industrielles à cycle court : Hévéa, Eucalyptus, peuplier, merisier….
Les variétés clones s’auto reproduisent très facilement. Elles peuvent être maintenues conformes à elle-même à partir d’un faible effectif de plantes, voir une seule plante. En général, la certification officielle des plants et semences de variétés clones s’effectue à partir d’une seule plante d’origine (« tête de clone »), pour veiller à la conformité et la stabilité parfaite.
La vie d'une variété
La vie d’une variété débute chez le sélectionneur/obtenteur qui l’obtient en créant par croisements de plantes de nouvelles combinaisons génétiques regroupant des caractères d’intérêt à partir des variétés élites, de lignées parentales voire en allant chercher des gênes plus originaux pouvant être présents dans les ressources génétiques et en la sélectionnant parmi les croisements réalisés. Cette phase dure en moyenne 10 ans, elle est très variable selon les espèces et les techniques utilisées.
Pour les espèces où l’inscription au Catalogue est obligatoire, l’obtenteur la propose ensuite à l’inscription. La période où sont conduites les études d’inscription dure en général 2 ans (les études et les règles de décision sont présentées dans les rubriques par espèces).
C’est pendant cette période que les organismes économiques, futurs distributeurs des variétés commencent à les évaluer pour se positionner sur les innovations les plus intéressantes pour leur marché.
Les caractéristiques des variétés décrites au moment de l’inscription, sont précisées et complétées par les instituts techniques et les utilisateurs des productions (meuniers, sucrerie, ..), pour que les variétés puissent être utilisées dans les meilleures conditions. Pour pouvoir être développée en culture la variété doit être maintenue, les semences produites.
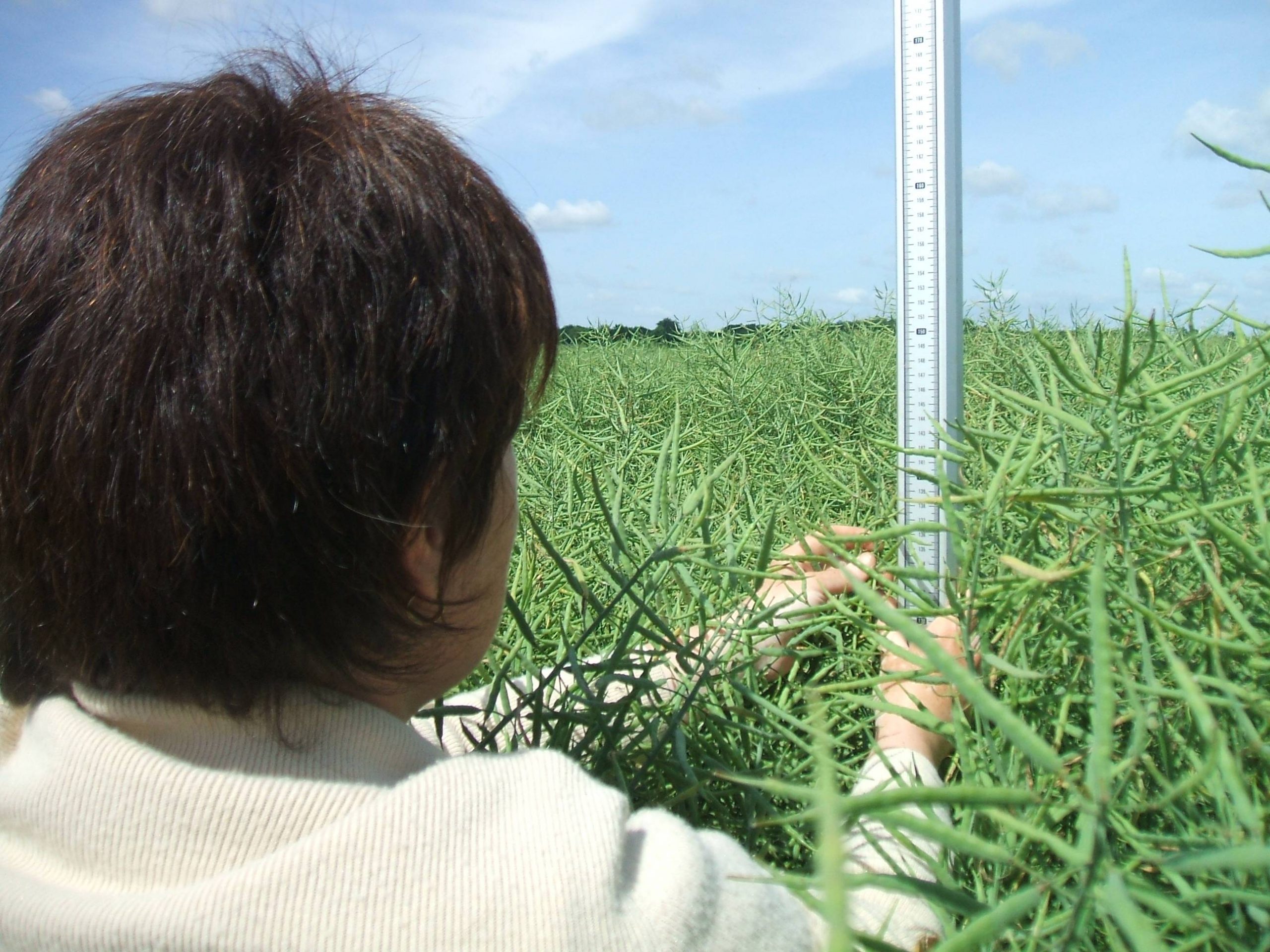

Le mainteneur de la variété est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité du maintien du matériel végétal vivant (semences ou plants) permettant la reproduction de la variété conforme à son identité telle qu’elle a été établie au moment de son inscription (on parle également de sélection conservatrice).
La production commerciale de semences et plants est assurée par les agriculteurs et établissements professionnels en charge de la multiplication et du conditionnement de cette production destinée à la mise sur le marché.
La durée de vie d’une variété en culture est très variable, selon les espèces et l’intérêt de la variété. L’inscription d’une variété est valable pour 10 ans, renouvelable par période de 5 ans. Le renouvellement ou la radiation d’une variété sont prononcés sur demande du mainteneur ou dans le cas d’un défaut de maintenance pour les plantes légumières. Pour les variétés de vigne, il n’y a pas de limite dans la durée de l’inscription.
Pour les grandes cultures, l’âge moyen d’une variété inscrite sur la liste A est de 6-7 ans pour un maïs et de presque 20 ans pour une pomme de terre. Les variétés de pomme de terre Bintje et Belle de Fontenay sont inscrites depuis 1935 au catalogue Français. Pour les blés tendres, les 2 variétés les plus anciennement inscrites en liste A, sont Courtot (1974) et Camp Rémy (1980), 2 variétés recherchées par les meuniers.
Quand la variété est radiée des catalogues français et communautaire, elle peut être introduite dans les réseaux de conservation des ressources génétiques ou être éventuellement, dans le cas des légumières, reproposée à l’inscription, notamment sur la liste des variétés « sans valeur intrinsèque destinées à l’autoconsommation ». Cette réinscription nécessite l’identification d’un ou de plusieurs mainteneurs pour ces variétés dites « anciennes ».
Aujourd’hui les différentes étapes, création variétale, maintenance, production et mise en marché des semences et plants, production et transformation des produits de récolte sont réalisées par des acteurs économiques spécialisés. Chacun de ces acteurs cherche à connaitre les caractéristiques de la variété et accumule des données sur elle. Une variété est évaluée tout au long de sa vie. A l’heure actuelle, la profession cherche à renforcer le continuum de cette évaluation en capitalisant les connaissances acquises.








